XIXe siècle
-

Pour fixer la trace interroge des écrits qui, au XIXe siècle, partagent un objet commun, non-littéraire, la photographie. Cette dernière inaugure un type de représentation, apparemment opposé à celui que propose la littérature. Des textes d’écrivains, d’historiens, de critiques, contribuent directement ou indirectement, à questionner cette rencontre problématique. Autour de Maxime Du Camp et de son Egypte, Nubie, Palestine et Syrie – le premier livre français illustré de photographies –, se constitue un champ intellectuel qui mérite d’être cerné. Creuset d’une réflexion « littéraire » sur la photographie, il impose un éclairage nouveau sur des œuvres littéraires connues. La situation de Maxime Du Camp dans le monde littéraire et éditorial, ses prises de position théoriques sur les arts et la littérature, permettent de comprendre la place de la photographie dans l’histoire culturelle du XIXe siècle.
De la confrontation de grands textes de fiction, de récits de voyages, de travaux d’histoire, de commentaires d’épreuves photographiques se dégage une sensibilité commune, de l’ordre d’un modèle culturel, que la photographie structure de manière spécifique. Un motif traverse ce corpus de textes émanant pourtant de sources diverses : celui du « faire-vivre ». Il définit la spécificité ontologique de la photographie, tout en posant une question fondamentale à l’écriture de type historique et fictionnel. Il est au cœur de l’écriture du voyage. Autour de lui se cristallise la tension entre réel et imaginaire d’une part, entre photographie et texte descriptif d’autre part, dont il s’agit de définir les termes dans l’épistémologie du siècle des Lumières et d’étudier les variations jusque dans le discours de la critique littéraire de la fin du XIXe siècle. Le « faire-vivre » régit aussi stylistiquement un genre que la photographie renouvelle : l’ekphrasis, ou les moyens que s’offre un texte pour restituer par la parole les qualités de présence et d’attestation propres à la photographie.
-

Sommaire: V. Branca, «Apertura del Convegno»; G. Ricuperati, «La cultura italiana nel secondo Settecento europeo»; S. Moravia, «La filosofia degli “idéologues”. Scienza dell’uomo e riflessione epistemologica tra Sette e Ottocento»; L. Sozzi, «L’idea di illusione tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento»; M. Cerruti, «Dalla “sociabilité” illuministica al mito del poeta solitario. La musa saturnina»; C. Capra, «“L’opinione regina del mondo”. Percorsi dell’evoluzione politica e intellettuale di Pietro Verri»; P. Del Negro, «Rappresentazioni della guerra in Italia tra Illuminismo e Romanticismo»; M. Pastore Stocchi, «Cenni su alcune traduzioni neoclassiche»; G. Baldassarri, «Cesarotti fra Omero e Ossian»; G. Pizzamiglio, «Illuminismo e Neoclassicismo a Venezia»; A. Fabrizi, «Le discussioni sulla lingua nel secondo Settecento: da Baretti a Galeani Napione»; P. Adinolfi, «L’idea di felicità tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento»; A. Motta, «I cambiamenti della forma-romanzo fra Illuminismo e Romanticismo: il caso Piazza»; F. Fido, «La storia a teatro. Dalla tragedia settecentesca e alfierianai componimenti teatrali di Giovanni Pindemonte»; G. Santato, «Un itinerario intellettuale tra Illuminismo e Rivoluzione: Alfieri e Voltaire»; A. Di Benedetto, «Da Goethe a Platen: momenti della fortuna di Alfieri in Germania»; E. Bonfatti, «L’antologia tedesca di Aurelio de’ Giorgi Bertola»; E. Guagnini, «Il viaggio, lo sguardo, la scrittura. Generi e forme della letteratura odeporica tra Sette e Ottocento».
-

Aussi réputées, sans doute, que méconnues, les Questions de littérature légale furent publiées anonymement en 1812, puis rééditées seize ans plus tard, sous une forme " considérablement augmentée ", par le désormais Bibliothécaire du Roi à l’Arsenal. Prisées des gens du livre au XIXe siècle, elles constituent encore de nos jours une référence dans tous les travaux critiques concernant le pastiche, le plagiat, les supercheries littéraires et autres doctes bagatelles. Or la " bavarderie bibliologique ", comme toujours chez Nodier, ne donne pas seulement lieu à des analyses aussi piquantes que sagaces de l’imitation, de l’emprunt, des procédés stylistiques ou de la figure de l’auteur ; par le biais d’une poétique dissuasive qui invoque " l’attention des gouvernements et la prévoyance des lois ", et tout en appelant de ses vœux une morale publique qui contraigne chaque écrivain à se montrer vertueux, le facétieux érudit n’en compose pas moins un manuel pratique de falsification textuelle. Richement annotée, la présente édition fait justice à cette œuvre depuis longtemps indisponible, dont l’érudition volontiers ironique et allusive rend la lecture captivante comme celle d’un conte romantique.
-

Cet ouvrage collectif important rassemble des travaux issus des recherches récentes sur l’histoire du Crédit Lyonnais. Il comprend 41 contributions, divisées en cinq parties: l’entreprise Crédit Lyonnais en elle-même, à travers ses hommes, ses structures, ses métiers, ses relations sociales et conflits du travail; le financement de l’économie; l’internationalisation de la banque, des agences de l’Empire Ottoman et d’Egypte à celles de Londres et de Genève; les rapports du Crédit Lyonnais avec son environnement (concurrence, marché financier, Etat, presse); enfin les réactions de la banque face aux épreuves de l’histoire, avec notamment une étude pionnière sur une banque sous l’Occupation. Ce recueil restitue ainsi l’image d’une banque à la personnalité marquée et toutefois représentative du système bancaire français des années 1860 aux années 1980, en associant, dans un fécond mouvement entre histoire et mémoire, des articles d’universitaires à des témoignages d’anciens acteurs de la vie de l’établissement.
-
-

Fictions de l’ipséité analyse les œuvres de Beckett, Hesse, Kafka, Musil, Proust et Woolf à la lumière de l’«autobiographie fictive» imaginée par Hesse: sous le masque des personnages inventés, ces auteurs remodèlent leur moi et recomposent leur vie en les transposant dans une représentation mythique de Soi. Par la mise en scène de situations extrêmes (exil, errance, échec, maladie, mort), par le recours à la figuration théâtrale, picturale et musicale, la fiction procure une représentation appropriée de ce Soi inventé, instance insaisissable et quasi divinisée de l’excès. Il fallait cette approche nouvelle d’œuvres majeures pour mettre en évidence la logique qui préside à la personnalité et aux aventures de leurs héros. L’indétermination, l’anonymat, les formes de rupture et de marginalité (fuite, folie, transgression, avilissement) récurrentes dans ces œuvres sont en effet interprétés comme l’attitude de soustraction et de négation, grâce à laquelle, paradoxalement, le héros – et à travers lui son auteur – s’érige en un Moi superlatif.
-
Cette édition critique présente dans leur ordre chronologique tous les écrits politiques de Chateaubriand entre 1814 et la fin de 1816. Témoignages d’une époque politiquement très dense, reflétant les débats qui marquèrent la chute de Napoléon, la Première Restauration et le rétablissement de la monarchie, les Cent-Jours, puis les débuts de la Seconde Restauration, ils présagent la carrière politique d’un Chateaubriand destiné à devenir Ministre des Affaires étrangères ; ils récapitulent également la pensée d’un des promoteurs de la monarchie constitutionnelle ; ils expriment enfin la recherche d’une manière de dire et d’écrire la chose politique. Tour à tour journaliste, historien, polémiste, partisan de la liberté de la presse, catéchiste constitutionnel, à la fois conservateur et libéral, Chateaubriand enterre le vague des passions pour devenir homme d’action.
-
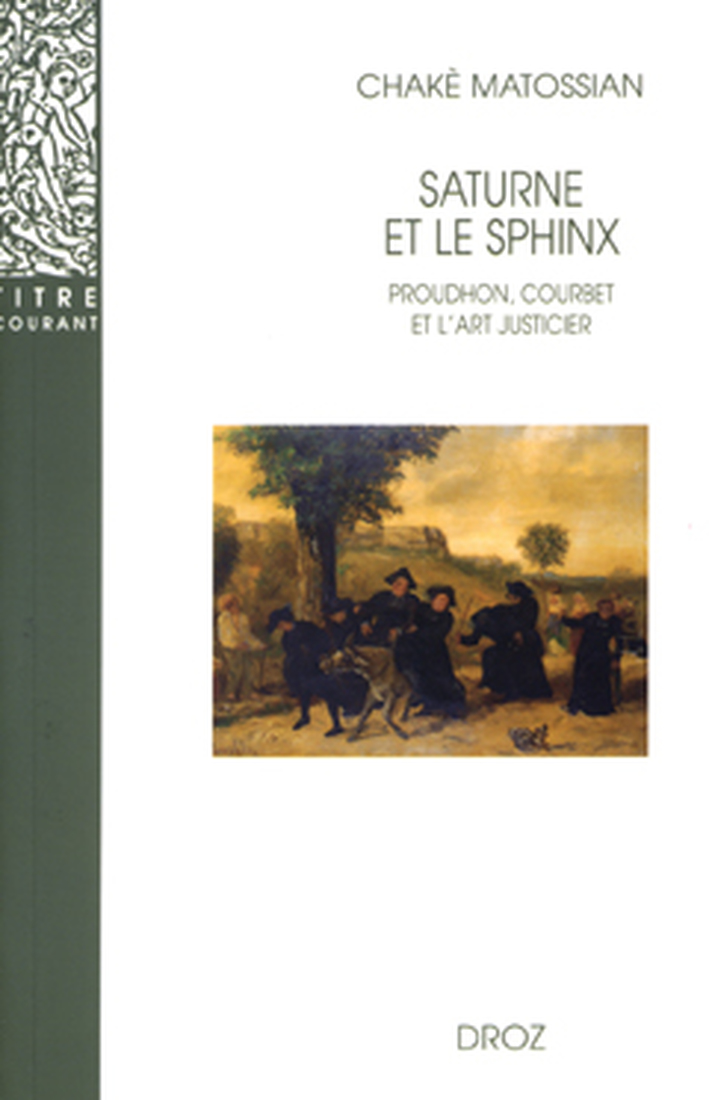
L’art peut-il se soustraire à la question de la tyrannie ? La servitude volontaire résulte d’effets d’hypnose, elle procède d'un assoupissement de la vigilance du spectateur, entretenu par la croyance en l’image. Il incombe dès lors au philosophe d’en démonter le piège, de départir le plaisir de la représentation du leurre qu’elle produit. En posant le regard sur l’œuvre de Gustave Courbet, Pierre-Joseph Proudhon, l’anti-tyran, investit cette problématique, qui, d’emblée, est nécessairement celle du rapport au réel. Qu’est-ce qu’une ligne ? Peinture et écriture révèlent, dans leur entrelacement, dans la relation spéculaire de leur tracé, que l’enjeu de l’acte créateur est la liberté, question de vie et de mort. En ce sens, s’il a une destination sociale, l’art ressortit au politique et à la médecine. Ainsi semble-t-il indispensable de repérer l’imaginaire médical et de le définir en tant que moteur de la pensée esthétique de Proudhon. L’examen de la dépendance de l’art au public et à l’espace public peut-il échapper au discours oraculaire ? Comment décider de l’écart entre destin et destination ? Reprenant ce questionnement à la suite de Kant, Proudhon trouve dans le symbole qu’il appelle " plus ou moins mythique " la seule figure possible d’un avenir qui, dans sa plénitude, se dérobera inévitablement. A l’instar de Saturne, Proudhon tranche. En tranchant, il trace. En traçant, il tranche.
-

Voici la diplomatie examinée selon un modèle inédit de l’histoire culturelle et sociale : ce sont les expériences individuelles et collectives, les connaissances européennes sur l'Autre, non-européen, et les techniques d'interaction – l’usage linguistique, le cérémonial d’audience, la pratique du tribut et du don entre autres – qui fournissent à l’analyse sa matière.
L'étude biographique, objet de la première partie, rend compte de la variété du contexte socioculturel dans lequel évolue un consul et chargé d'affaires français près une cour maghrébine, à Tunis en l'occurrence. Christian Windler peint ce notable, expatrié, membre d’un corps d’intermédiaires spécialisés en voie de constitution, alliant l’expérience qu’il a des relations diplomatiques à celle qu’il fait de l’interaction entre les pouvoirs locaux et les autorités en France.
Les trois parties suivantes saisissent l’évolution de la culture diplomatique, dans un milieu qui, durant le XVIIIe siècle, est pénétré par la propagation des contacts pacifiques entre chrétiens et musulmans. Issu des révolutions de la fin du siècle, un nouvel ordre international met en question le système diplomatique jusqu’alors pluraliste. C’est désormais la prépondérance des puissances européennes qui façonne, différemment, la coexistence du diplomate et de l’Autre dans le bassin méditerranéen.
Christian Windler est professeur au Séminaire d’Histoire de l’Université de Fribourg-en-Brisgau.
-

Biographes comme admirateurs de l’écrivain genevois Rodolphe Töpffer (1799-1846) souhaitaient que sa correspondance fût éditée. Quiconque avait pu, en effet, consulter ses lettres déposées à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève y retrouvait l’humour de l’auteur des Histoires en estampes – dont les héros sont, entre autres, Jabot, Crépin, Vieux-Bois et Festus –, le charme des Nouvelles genevoises, la spontanéité de l’écriture et des dessins des Voyages en zigzag.
Jacques Droin, ancien magistrat, président pendant deux décennies de la Société d’études töpffériennes de Genève, s’est attelé à la tâche de transcrire et d’annoter les quelque mille cinq cents lettres que nous a laissées Töpffer. L’édition qui en ressort fera connaître le caractère attachant d’un écrivain de la première moitié du XIXe siècle, qui fut à la fois professeur des traditions genevoises et chef de pensionnat, un dessinateur humoristique à l’origine d’un genre nouveau, auquel la bande dessinée est redevable, un critique d’art et l’initiateur de la peinture alpestre helvétique. Ce premier tome contient les lettres que Rodolphe échangea avec sa famille et avec ses proches durant son séjour parisien, au cours duquel il devait renoncer à sa vocation de peintre, héritée de son père Adam-Wolfgang Töpffer, en raison d’une faiblesse de la vue pour finalement embrasser la carrière de professeur.